"Science, Recherche, Société. Statut Relationnel: Complexe."
- mariealixdalle
- 16 sept. 2021
- 5 min de lecture
Dernière mise à jour : 24 févr. 2022
https://science.lu/fr/science-writing-competition-2021/science-research-society-relational-status-complex
Participation à la compétition d'écriture scientifique organisé par Uni.lu et FNR (2nd prix)
À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot "science" ? Et qu'est-ce que la recherche ? Comment sont-elles "fabriquées" ? Et quel est leur rôle dans la société ?
Que ce soit lors de discussions sur la pandémie, le changement climatique ou d'autres sujets scientifiques, les termes "science" et "recherche" sont souvent utilisés de manière interchangeable. Mais ils ne sont en fait pas les mêmes.
Quelle est la différence entre la science et la recherche ?
La science est la connaissance communément établie et acceptée du monde qui nous entoure, nous aidant à mieux le comprendre ; tandis que la recherche est le processus basé sur la science existante et menant à une nouvelle science, en remettant en question les observations, sur la base des connaissances existantes, des expériences, des hypothèses...
Parfois, la science existante peut s'avérer fausse et est mise à jour par la recherche. Par exemple, au Moyen Âge, on supposait que l'ablation du sang était le meilleur moyen de guérir la plupart des maladies, avant de mieux comprendre le corps humain et de trouver de meilleurs traitements. Autre exemple : il a fallu quelques années avant que l'importance du nettoyage des mains ne soit reconnue, après qu'un médecin ait observé que les femmes qui accouchaient mouraient moins si le médecin s'était lavé les mains auparavant.
Les chercheurs continuent de faire progresser la science. Les observations, les questions et les doutes, la confrontation entre la théorie et les faits, sont à la base de la recherche et constituent le moteur de la science.
Y a-t-il une limite au doute ?
Il est vrai qu'au cours de l'histoire des sciences, les théories ont évolué plusieurs fois, et parfois avec de grandes difficultés pour lutter contre un dogme dominant. Aujourd'hui, de meilleurs outils d'observation et de plus grandes capacités de calcul nous permettent d'apporter des preuves solides et indiscutables pour - ou contre - certaines théories. Par exemple, les microscopes nous permettent de voir réellement les micro-organismes à l'origine des maladies. L'avènement des microscopes a donc constitué une étape importante dans l'établissement de la théorie des germes, aujourd'hui largement acceptée.
Cependant, à ce jour, il existe encore des principes scientifiques que personne n'a jamais pu prouver, et pourtant ils sont considérés comme vrais parce que personne n'a jamais pu prouver qu'ils étaient faux non plus. Et mieux encore, les dispositifs créés sur la base de ces principes fonctionnent parfaitement bien. En effet, la plupart des moteurs de voitures sont basés sur les premier et deuxième principes de la thermodynamique, que le perpetuum mobile tente d'invalider, sans succès jusqu'à présent.
Infobox
Premier et deuxième principes de la thermodynamique
La thermodynamique est l'étude du comportement de la chaleur et de l'énergie. Le premier principe stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais qu'elle peut être transformée d'une forme à une autre ou transférée d'un objet à un autre. Dans le moteur de votre voiture, la chaleur est transformée en mouvement. Le deuxième principe de la thermodynamique stipule qu'aucune réaction n'est efficace à 100 % : une certaine quantité d'énergie est toujours perdue en chaleur.
Le perpetuum mobile
Pendant de nombreuses années, les inventeurs ont essayé de créer une machine qui pourrait fonctionner éternellement - un "perpetuum mobile". Cependant, à ce jour, aucun modèle n'a pu surmonter l'effet de ralentissement de la friction. Toutes les machines perdent progressivement de l'énergie, ce qui rend malheureusement le mouvement perpétuel impossible - du moins jusqu'à preuve du contraire.
Il y a donc une énorme différence entre des scientifiques célèbres, comme Galilée, qui se battent contre d'anciens dogmes ou croyances, et le doute que certains ont aujourd'hui à l'égard de principes éprouvés ayant des applications physiques et fructueuses, même si leur exactitude n'a pas encore été prouvée.
Quelle est la différence entre une croyance et un fait ?
Nous pourrions distinguer les croyances des faits en disant que les croyances ne peuvent être prouvées. Cependant, il existe aussi des choses que nous croyons vraies parce que nous les ressentons et que nous pensons donc que cette sensation est une preuve. Mais parfois, nos sens ne nous donnent pas une image fidèle des faits. Par exemple, lorsque nous touchons un morceau de métal et un morceau de plastique qui sont restés dans la même pièce pendant un certain temps, nous sommes tentés de dire que, selon nos sens, l'aluminium est plus froid que le plastique. Mais lorsque l'on mesure la température des matériaux, il s'avère qu'ils sont à la même température !
La science est donc très importante pour comprendre nos sens et les faits en général et être capable de les interpréter correctement. De plus, il est très important de savoir comment les différents faits scientifiques ont été découverts [2][3], afin qu'ils restent des faits scientifiques et ne deviennent pas des croyances. [1]
Jusqu'à quand devons-nous faire confiance à la science ?
Si parfois nos sens nous trompent et que seule la science peut nous aider à comprendre ou nous donner une représentation fidèle de la réalité, il arrive aussi que la science soit utilisée pour nous tromper et déformer cette réalité : pour disculper l'industrie du tabac par exemple, ou pour prôner un petit-déjeuner lourd et gras [4].
Par exemple, certaines personnes nient l'augmentation de la température mondiale en se concentrant sur les 10 dernières années d'enregistrement de la température mondiale et en montrant que la courbe est presque plate. Cependant, lorsqu'on examine l'ensemble des données sur des centaines d'années, on constate une nette augmentation au cours des dernières décennies. D'autres contestent la disparition des ours polaires, car ils comptent le nombre d'ours d'une population très spécifique qui est en fait en augmentation, probablement en raison de changements dans les politiques de chasse, alors que partout ailleurs et au total, la population diminue.
Noyer l'auditoire sous les chiffres et les graphiques et une apparente méthode scientifique appliquée à un ensemble de données incomplètes ou erronées est un bon moyen de détourner l'attention des véritables informations. Et les graphiques sont facilement manipulables pour vous faire croire ce que l'auteur veut vous faire croire. De même que le point de vue (macro ou micro) d'une photo change toute la scène, l'échelle des axes et les liens suggérés entre les variables peuvent conduire à des interprétations très différentes d'un même fait.
Pour conclure...
En résumé, nous pouvons constater qu'en ces temps d'information abondante et facilement accessible pour tous, la science et la recherche ont la vie dure. Il est de la responsabilité de chacun d'entre nous de s'assurer de comprendre ce que nous partageons et comment cela a été découvert, et de questionner, vérifier et multiplier les sources d'information pour éviter de se laisser berner par une propagande déguisée en méthodes scientifiques ; sans tomber dans le travers inverse qui consiste à douter de tout et à prendre la science pour la recherche ou l'inverse.



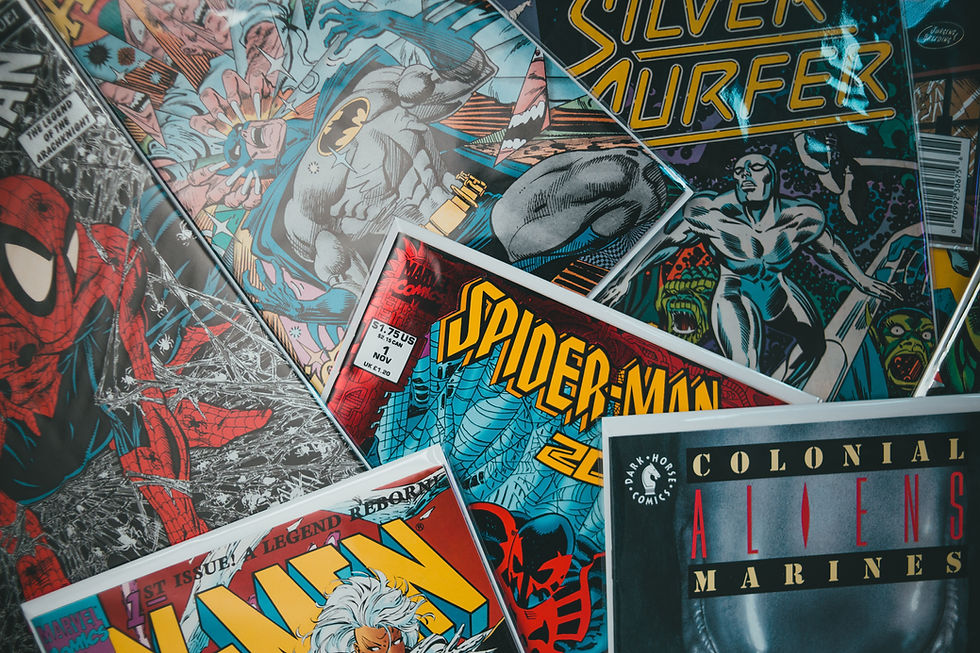
Commentaires